Finance durable : SFDR, Taxonomie verte et lutte contre le greenwashing

En 2025, la finance durable n’est plus une niche : elle concentre désormais 84 % des encours de fonds en Europe au troisième trimestre 2024, soit près de 3 300 milliards de dollars d’actifs. AInsi, portés par des investisseurs exigeant transparence et impact, ces montants devraient encore progresser avec l’entrée en vigueur de la CSRD et la consolidation des cadres de reporting extra-financier.
Pourtant, l’avalanche de sigles (ESG, ISR, ODD, green bonds) et la crainte du greenwashing rendent la lecture complexe. Cet article décrypte :
- les concepts clés et leur histoire,
- la nouvelle règlementation européenne (SFDR et Taxonomie verte),
- les tendances marché 2025 et les risques à surveiller,
1. Qu’entend-on par finance durable ?
La finance durable vise à créer de la valeur à long terme en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à chaque décision financière. Ainsi, ses racines remontent aux mouvements éthiques des années 1970, puis se professionnalisent au fil des crises corporate (Enron, subprimes, marée noire de BP) qui soulignent l’impact financier d’une gouvernance défaillante ou de pratiques polluantes.
Aujourd’hui, deux principes structurent l’analyse :
- Matérialité financière (outside-in) : comment le climat, la réglementation ou la réputation affectent la performance d’un portefeuille.
- Matérialité d’impact (inside-out) : comment l’entreprise influence l’environnement et la société. La double matérialité combine ces deux regards et devient la norme réglementaire.
2. Le cadre réglementaire européen : SFDR et Taxonomie verte

2.1. SFDR : classifier les fonds pour lutter contre le greenwashing
| Catégorie | Positionnement | Exigences clés |
|---|---|---|
| Article 6 | Fonds traditionnels | Pas de cible ESG ; information limitée sur les risques durabilité |
| Article 8 | Fonds « caractéristiques ESG » | Preuve d’intégration systématique des critères ESG |
| Article 9 | Fonds « objectif durable » | 100 % des investissements doivent être durables au sens de l’UE |
Remarque : une version « 8+ » exige un pourcentage minimal d’investissements alignés sur la Taxonomie, resserrant l’étau autour des argumentaires marketing.
2.2. Taxonomie verte : un langage commun pour évaluer l’impact
La Taxonomie verte définit si une activité économique contribue substantiellement à l’un des six objectifs environnementaux :
- Atténuation du changement climatique
- Adaptation au changement climatique
- Ressources hydriques et marines
- Économie circulaire
- Prévention de la pollution
- Protection des écosystèmes
Enfin, pour être alignée, une activité doit également :
- Ne pas nuire significativement aux autres objectifs (principe DNSH) ;
- Respecter des garanties sociales minimales (OIT, Pacte mondial).
La proportion d’un portefeuille « alignée Taxonomie » devient ainsi un indicateur synthétique de crédibilité durable. Chez Leboncourtier, nous l’utilisons pour comparer des unités de compte a priori similaires et privilégier celles dont la transparence est la plus élevée.
3. Tendances marché 2025 : croissance, biodiversité et standardisation

- Domination des fonds durables : la part de marché des fonds à caractéristiques ESG ou à objectif durable continue de progresser. Ainsi, le cap des 4 000 Mds $ devrait être franchi en Europe d’ici fin 2025, porté par la demande retail et l’assurance‑vie.
- Biodiversité et nature‑based finance : après le climat, les gérants lancent des fonds et obligations dédiés à la protection des écosystèmes (biodiversity bonds). De plus, le référentiel TNFD, jumeau nature de la TCFD, standardise la mesure des risques liés à la nature.
- Standardisation des données : la CSRD et les normes ESRS imposent un socle commun. Le déploiement d’outils de data ESG de qualité réduit l’écart de lecture entre investisseurs et améliore la comparabilité des fonds.
4. Risques à surveiller : greenwashing et activisme actionnarial
4.1. Greenwashing systémique : l’exemple DWS
Le cas DWS illustre les dérives possibles : méthodologies floues, exclusions partielles, incohérences entre marketing et portefeuille. C’est pourquoi pour limiter ces risques, les gestionnaires de fonds :
- exigent des indicateurs chiffrés (trajectoire carbone, part Taxonomie),
- vérifient la cohérence entre le nom du fonds et ses positions réelles,
- contrôlent la qualité du label (audit externe, indépendance du certificateur).
4.2. Activisme ESG : l’exemple ExxonMobil
L’épisode ExxonMobil rappelle qu’une stratégie climatique faible peut attirer des fonds activistes et créer de la volatilité ; à l’inverse, une gouvernance ouverte à l’engagement peut transformer un risque en opportunité.
Ainsi, en 2021, un fonds activiste a fait élire des administrateurs chez un géant pétrolier pour accélérer son virage climatique, illustrant :
- La vulnérabilité des sociétés sans feuille de route ESG crédible ;
- Le pouvoir des actionnaires à défendre la valeur long terme.
Conclusion – Agir maintenant pour concilier performance et impact
La combinaison SFDR + Taxonomie transforme durablement le marché. Aussi, les opportunités sont nombreuses, à condition de séparer le signal de l’écume. Avec son expertise réglementaire et son approche centrée sur la double matérialité, Leboncourtier se positionne comme votre allié pour :
- Protéger la performance de vos portefeuilles ;
- Répondre aux exigences croissantes de vos clients ;
- Mais aussi contribuer concrètement à la transition environnementale et sociale.



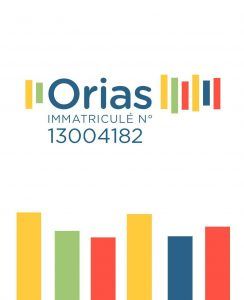


Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !